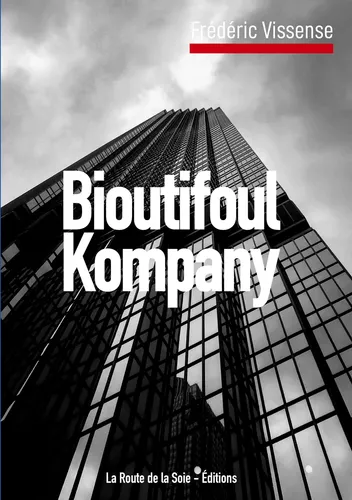Bioutifoul Kompany : l’éveil brutal dans le théâtre-monde du faux
« L’entreprise n’est plus ce qu’elle était : c’est une religion, une armée, un théâtre, un système d’endoctrinement. Et peut-être un suicide collectif. »
Ce n’est pas un roman, ni un pamphlet. Ce n’est pas une fable, ni une dystopie. C’est un miroir. Un miroir déformant, cruel, ironique, mais fidèle. Bioutifoul Kompany est un livre-monde. Un cri. Une mise à plat du monde tel qu’il fonctionne — ou plutôt dysfonctionne — sous les habits policés de la modernité capitaliste.
Frédéric Vissense s’attaque à ce qu’il nomme la « Compagnie Universelle d’Innovation » : un monstre tentaculaire, à la fois start-up de l’absurde, multinationale vorace, laboratoire de marketing totalitaire et fabrique d’aliénation de masse. Mais derrière cette parodie de société, c’est bien la nôtre qui est mise en scène, disséquée, exposée. Sans filtre. Sans anesthésie.
Une langue de la dissection
Le livre surprend d’abord par son langage. Déroutant, hybride, il mêle jargon managérial, lexique poétique, néologismes frappants et phrases-tranchantes comme des slogans. Chaque mot est choisi, pesé, dynamité. Car ici, le langage est politique. Il devient l’arme du faux, le masque du réel, le piège dans lequel nous tombons tous — consommateurs, travailleurs, rêveurs. L’auteur démonte ces mots qui nous gouvernent : « transversalité », « innovation », « disruption », « excellence »… autant de mantras creux, de faux-semblants. La langue de l’entreprise est une novlangue. Et ce livre est sa traduction critique.
Philosophie du simulacre
Il y a du Guy Debord dans ces pages, du Jean Baudrillard aussi. L’entreprise n’est pas seulement un lieu de travail : elle est devenue le centre d’un système de croyances. Bioutifoul Kompany le dit avec une précision chirurgicale : le management est un culte. On ne cherche plus la vérité, mais la conformité. La pensée est remplacée par l’adhésion. Le salarié devient « collabor’acteur », le doute devient « zone de non-performance », l’éthique est réduite à des chartes qui servent à se laver les mains.
Frédéric Vissense interroge ainsi, en profondeur, la métaphysique du capitalisme contemporain. Ce n’est plus le profit qui le définit, mais l’organisation de l’illusion. Une illusion qui structure nos désirs, nos relations, nos imaginaires. Une illusion qui colonise même nos révoltes — prévisibles, recyclables, managées.
Une esthétique de la chute
Le livre est construit comme une descente. On pénètre dans un univers de plus en plus absurde, cynique, violent. Une sorte de Comédie inhumaine où les figures qui peuplent la Kompany sont à la fois grotesques et effrayantes. DRH spectrales, coachs toxiques, ingénieurs déshumanisés, poètes corporate, responsables de l'inutile. À chaque page, un portrait, un mécanisme, une absurdité.
Mais l’humour est là, toujours. Noir, grinçant, salvateur. C’est l’humour comme résistance. L’humour comme philosophie. Celui qui permet de regarder en face la laideur du monde sans sombrer. Celui qui, paradoxalement, nous rend plus lucides.
Un appel à sortir du faux
Ce qui rend ce livre si fort, ce n’est pas seulement sa charge critique. C’est son invitation. Sa main tendue. Car derrière la satire, il y a une question : que faire ? Comment réapprendre à penser ? À sentir ? À être, tout simplement ? Comment sortir du théâtre du faux pour redevenir acteur de sa propre vie ?
Bioutifoul Kompany n’apporte pas de solutions. Il fait mieux : il rouvre les yeux. Il brise les slogans. Il rend à chacun sa propre interrogation. Il est ce moment rare où la littérature rejoint la philosophie pour questionner le monde à la racine.
Et cela, aujourd’hui, est une forme de résistance.