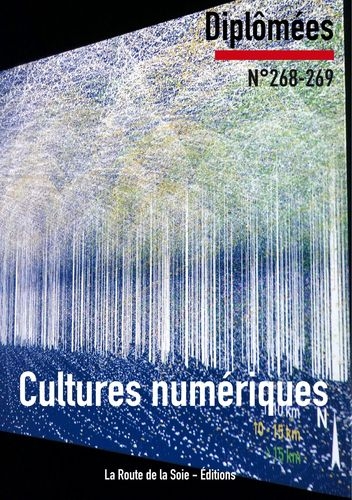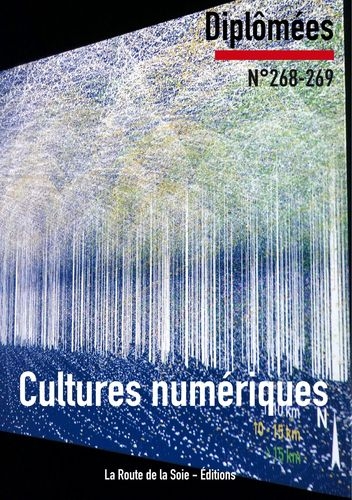 La Revue Diplômées est une revue de l’Association Française des Femmes diplômées de l’Université. Revue scientifique à comité de rédaction, elle a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. D’inspiration généraliste et interdisciplinaire, libre à l’égard de toute école de pensée et des modes intellectuelles. Sa périodicité est de quatre numéros par an, elle accueille ainsi des textes théoriques et de recherches.
La Revue Diplômées est une revue de l’Association Française des Femmes diplômées de l’Université. Revue scientifique à comité de rédaction, elle a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. D’inspiration généraliste et interdisciplinaire, libre à l’égard de toute école de pensée et des modes intellectuelles. Sa périodicité est de quatre numéros par an, elle accueille ainsi des textes théoriques et de recherches.
Dans ce numéro de Diplômées nous interrogeons les nouvelles pratiques culturelles afin de tenter de circonscrire la culture à l’heure du « tout numérique ».
Parler des cultures numériques, c’est parler des choses qui fâchent comme l’obéissance (soumission librement consentie), la mondialisation, l’obsolescence programmée, de la culture de masse, des inégalités numériques, de l’intelligence artificielle, des biais cognitifs entretenus ou créés, et en arrière plan la privatisation des enjeux géopolitiques…
Cependant parler des cultures numériques, c’est aussi parler des choses qui étonnent comme l’évolution des comportements : la sexualité, les amitiés, la créativité passe-t-elle par des templates (des pages pré-programmées où il suffit de copier-coller son texte), la vie en réseaux, les selfies (photographies de soi-même), l’entrée de l’Intelligence Artificielle dans le quotidien, la quantification de la vie humaine…
Créer un dossier sur les cultures numériques consiste à explorer de façon systémique un ensemble de champs de réflexion parmi lesquels, nous trouvons : l’économie, le social, le juridique, le politique, la géopolitique, les enjeux éthiques.
Ont participé à ce numéro : Aude Bernheim, Adrien Bernheim, Geneviève Bouché, Caroline Body, Carine Braun-Hénéault, Sonia Bressler, Isabelle Broué, Yvette Cagan, Marie-Thérèse Couy, Laurence Devillers, Monique Grandbastien, Xie Jing, Christine Martin, Sylvianne Masson, Claude Mesmin, Sylvie Octobre, Hélène Romano, Flora Vincent.