Un « gouvernement d’intérêt général » : solution ou piège pour la démocratie française ?
Dans la soirée du 4 décembre 2024, la motion de censure a été votée à l'Assemblée nationale, faisant de facto tomber le gouvernement sous la direction du Premier ministre Michel Barnier. En réponse à cette agitation politique, le Président Emmanuel Macron a pris la parole le jeudi 5 décembre à 20h. Comme on peut le voir sur le site officiel de l’Elysée, il s’agit d’une « adresse aux Français ». Face à une Assemblée nationale sans majorité et la censure inédite du gouvernement, le président appelle à la formation d’un « gouvernement d’intérêt général ». Si cette idée se veut une réponse pragmatique à la crise, elle soulève des questions fondamentales sur le fonctionnement démocratique de la Cinquième République.
Comme cela fait longtemps que je ne me suis pas prêtée à l’analyse des discours d’Emmanuel Macron, il me semble important de le faire aujourd’hui afin de poser clairement la question de la signification de l’expression de « gouvernement d’intérêt général ».
Une rhétorique de l’urgence et de l’unité
Le discours s’ouvre sur une situation exceptionnelle : la censure du gouvernement Barnier et l’impossibilité de dégager une majorité parlementaire claire. Macron mobilise une rhétorique de l’urgence pour justifier la nécessité d’une solution rapide. En présentant les oppositions comme un « front anti-républicain », il se positionne en garant de l’unité nationale et de la stabilité institutionnelle.
Ce qui, comme le souligne Clément Viktorovitch, est factuellement faux, et qui le positionne comme le seul sauveur. Cette rhétorique disqualifie tout contre-pouvoir. Elle renvoie dos à dos les extrêmes, marginalise les critiques légitimes et ignore le rôle de l’opposition dans une démocratie pluraliste. Comme l’a montré Chantal Mouffe (The Democratic Paradox), un consensus total est une illusion qui masque souvent la suppression des conflits légitimes.
Le recours au pathos est également frappant. Macron évoque les fêtes de Noël pour accentuer la responsabilité supposée des oppositions dans la crise. Cette stratégie émotionnelle sert à polariser le discours, renforçant son positionnement de « père de la Nation ». Toutefois, en établissant cette dualité simpliste entre « ordre » et « chaos », il empêche une véritable délibération publique.
Le « gouvernement d’intérêt général » : une idée constitutionnellement fragile
Le concept n’a pas de fondement explicite dans le droit constitutionnel français. La Constitution de 1958, pensée pour assurer la stabilité, repose sur la séparation des pouvoirs et le jeu des majorités parlementaires. Si l’article 49 permet de contourner les blocages, il ne saurait être un outil systématique pour gouverner. L’appel à un « gouvernement d’intérêt général » repose donc davantage sur une interprétation politique que sur une base juridique solide.
Un tel gouvernement, en prétendant représenter toutes les forces politiques, pourrait affaiblir l’opposition et concentrer le pouvoir dans les mains de l’exécutif. Cette dynamique peut mener à ce que Pierre Rosanvallon appelle une « démocratie d’évitement », où les mécanismes de délibération collective sont contournés au profit d’une gestion technocratique (Le Bon Gouvernement).
La fragilité institutionnelle de ce concept est également à replacer dans le contexte international. Contrairement à des pays comme l’Allemagne où les coalitions sont courantes, la Cinquième République française repose sur un fonctionnement binaire : majorité et opposition. Forcer un consensus artificiel pourrait créer davantage de tensions que de stabilité.
Une illusion dangereuse : entre autoritarisme et désengagement populaire
Le projet d’unité nationale masque les tensions inhérentes à toute démocratie. Comme le souligne Claude Lefort (Essais sur le politique), la démocratie vit de ses divisions et de ses conflits. Chercher à les effacer revient à nier le pluralisme, socle de toute société libre.
Le risque est celui d’un glissement vers un pouvoir technocratique ou autoritaire. En neutralisant les clivages politiques, le gouvernement pourrait être tenté d’agir sans réel contre-pouvoir, affaiblissant le rôle du Parlement. Hannah Arendt rappelle que de telles situations peuvent conduire à une érosion progressive des libertés (Les Origines du Totalitarisme).
Un gouvernement d’intérêt général peut également renforcer la défiance envers les institutions. Déjà en crise, la représentation politique risque de s’éloigner davantage des citoyens, laissant place à un cynisme dangereux. La philosophie politique contemporaine, notamment Habermas (Droit et démocratie), insiste sur l’importance de la participation citoyenne et du débat public pour légitimer les décisions.
Dans ce contexte, les médias jouent un rôle crucial. En reprenant la rhétorique d’urgence sans la nuancer, ils risquent d’accentuer la perception d’un éloignement entre gouvernants et gouvernés. Cela soulève des questions sur leur responsabilité dans l’érosion de la confiance publique.
Quels choix pour l’avenir démocratique ?
Le discours présidentiel pose une question essentielle : comment gouverner dans un contexte de fragmentation politique ? Si le « gouvernement d’intérêt général » peut sembler une réponse pragmatique, il ne saurait être une solution pérenne.
La crise actuelle révèle les limites de la Cinquième République. Une réforme institutionnelle pourrait renforcer la proportionnalité des élections législatives, favorisant une meilleure représentation des forces politiques. Une réflexion sur l’instauration d’un régime parlementaire plus équilibré semble également nécessaire.
Face à la défiance croissante, il est urgent de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions. Cela passe par une démocratisation des processus décisionnels et une plus grande transparence. Inspirons-nous des expériences participatives réussies, comme les assemblées citoyennes, qui permettent d’inclure les citoyens dans l’élaboration des politiques publiques.
Dans cette perspective, Dominique Motte propose un modèle de démocratie directe qui mériterait une exploration approfondie pour répondre à la crise actuelle.
L’unité, un leurre ou une ambition ?
Si l’idée d’un « gouvernement d’intérêt général » semble répondre aux blocages institutionnels, elle cache des dangers profonds pour la démocratie. En niant les conflits inhérents au politique, elle risque de renforcer les dynamiques autoritaires et de creuser la fracture entre gouvernants et gouvernés.
La France ne peut se contenter de solutions provisoires. Elle doit repenser ses institutions et réaffirmer le rôle central du citoyen dans la construction démocratique. Comme l’écrivait Rousseau, « la force publique est composée des forces privées : si elle est mal dirigée, elle détruit l’égalité ». Gardons cela à l’esprit en ces temps troublés.
Et, comme le souligne Hannah Arendt, « L’action, par définition, ne peut se produire dans l’isolement. Elle a besoin des autres pour se manifester » (Condition de l’homme moderne). Plutôt que de chercher à éviter les conflits, assumons-les pour les transformer en moteur de notre avenir collectif.

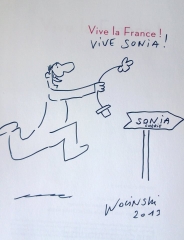 Si je devais reprendre les mots de ce jour. Je ne changerai rien. Ce sont eux qui ont réveillé ce blog, ce retour aux mots, au réveil des consciences. À ceux qui ne les avaient pas vus, pas pris... Je vous les redonne, à l'heure des hommages, à l'heure où l'on veut faire taire les mots (pardon les encadrer), nous devons prendre la parole. Hurler. Crier sans violence. Affirmer. Confirmer. Écrire & voir différemment toujours.
Si je devais reprendre les mots de ce jour. Je ne changerai rien. Ce sont eux qui ont réveillé ce blog, ce retour aux mots, au réveil des consciences. À ceux qui ne les avaient pas vus, pas pris... Je vous les redonne, à l'heure des hommages, à l'heure où l'on veut faire taire les mots (pardon les encadrer), nous devons prendre la parole. Hurler. Crier sans violence. Affirmer. Confirmer. Écrire & voir différemment toujours. 