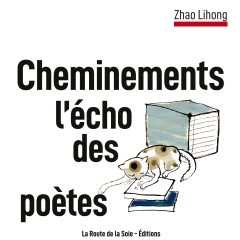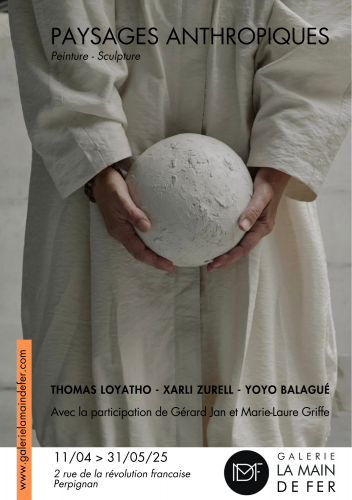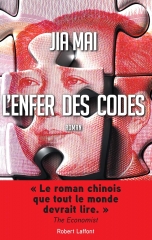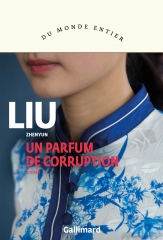Zhao Lihong : quand la poésie devient une manière d’être au monde
Dans un monde où l'accélération est devenue loi, Zhao Lihong nous invite à faire halte.
Dans un échange d'une rare profondeur avec la journaliste Camille Chen, diffusé ici, le grand poète chinois dévoile la source secrète de son écriture : non pas une ambition littéraire, mais un mode d'existence. Métamorphose(s) et Cheminement(s) : l’écho des poètes sont les deux pierres de ce sentier intérieur qu’il nous propose de suivre — à pas d’âme.
Se transformer sans se trahir
Au fil de l'entretien, Zhao Lihong évoque le cœur battant de Métamorphose(s) : cette capacité, douloureuse mais vitale, à accepter la transformation de soi.
Ici, la métamorphose n’est pas un exploit héroïque. Elle est douce, secrète, souvent invisible. Elle rappelle les paroles d’Héraclite : “On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.” Mais chez Zhao, le fleuve n’est pas violent : il est murmure, patience, glissement.
“Vivre, c’est accueillir le changement, même lorsqu’il nous effraie.” — Zhao Lihong
La poésie devient ainsi une méditation continue sur ce que signifie être vivant : un équilibre précaire entre permanence et impermanence, entre ancrage et passage.
Le dialogue silencieux avec les anciens
Avec Cheminement(s), Zhao Lihong nous emmène plus loin encore : sur les traces des poètes qui l'ont précédé, accompagnant ses propres pas dans la nuit du monde.
Dans cet ouvrage illustré de fines aquarelles, la parole devient écoute. Zhao ne parle pas seul : il converse avec Du Fu, Wang Wei, Li Bai — ces figures lumineuses de la poésie chinoise classique.
Mais plus qu'un hommage, Cheminement(s) est une interrogation : que reste-t-il de la poésie quand le monde change plus vite que la mémoire ne peut le retenir ?
La réponse de Zhao Lihong est à la fois humble et magnifique : il reste l’écho. Un écho discret, mais assez fort pour traverser les siècles.
Résister par la lenteur
Dans un passage saisissant de l'entretien, Camille Chen lui demande comment il perçoit notre époque saturée d'images et de bruits. Zhao Lihong répond sans colère, mais avec une gravité qui résonne :
“Le bruit du monde ne peut pas couvrir le murmure de la vie intérieure.”
À l'heure où l'homme moderne risque d’oublier son âme dans le fracas numérique, Zhao propose une résistance par la lenteur, par l'attention au minuscule, au presque rien.
C'est une réponse philosophique autant que poétique — une forme de stoïcisme lumineux.
On pense ici à la phrase de Pascal : “Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre.”
Zhao Lihong, lui, nous enseigne à habiter cet espace intérieur, non pas comme une prison, mais comme un jardin secret.
La poésie comme chemin d’éveil
Loin des slogans, loin des poses littéraires, Zhao nous livre une conviction simple et essentielle :
La poésie est un chemin de transformation du regard. Elle ne change pas le monde de l’extérieur. Elle nous change, nous. Elle aiguise notre perception, elle creuse notre capacité d’émerveillement, elle restaure la gravité du silence.
Métamorphose(s) et Cheminement(s) sont donc bien plus que des livres : ce sont deux invitations à devenir soi-même autrement, en écoutant les murmures enfouis du monde.