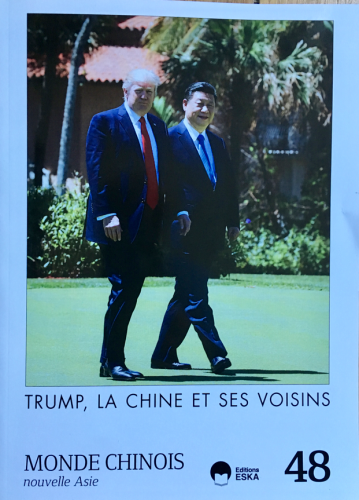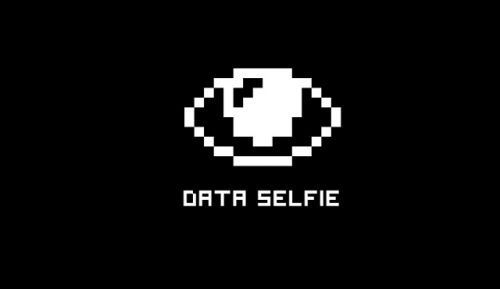Une fois n'est pas coutume, j'ai pris mon temps pour écrire à nouveau sur ce blog. Oui j'aurais pu commenter les élections présidentielles françaises, ajouter du bruit au brouillard démocratique. Vous dire que les dés étaient bipés depuis l'été. Evidemment, j'aurais développé l'idée que cette élection est le signe d'une victoire d'une génération sans mémoire. C'est le cas. Quand on vit dans l'immédiateté, on ignore son passé, sa culture... qui ignore son passé ne peut avoir d'avenir. Que tout ceci nous éloigne du sens de l'humanité. Vous voyez, j'aurais pu être pessimiste.
Hier, une étudiante, me dit : "quoi vous devriez être à Pékin et vous êtes là avec nous ! Mais vous êtes folle !" Sans doute, ai-je loupé l'occasion unique de rencontrer Xi Jinping, d'assister, en direct, à l'un de ses plus beaux discours. Sans doute.
La Route de la Soie un projet unique
Donc ce matin j'écoute en direct, mais depuis Paris, cette rencontre où 29 chefs d'état viennent parler de cette renaissance officielle de la Route de la Soie. Cette entreprise d'une envergure immense va redessiner le paysage géopolitique mondial. Elle vise à rouvrir et aménager des routes commerciales qui, pour certaines, empruntent les célèbres et antiques " routes de la Soie " suivies par les caravaniers du IIe siècle avant notre ère au XVe siècle. Ces routes je les ai empruntées, traversées pendant des mois en Chine. Par sa dimension, par les bouleversements culturels que cette route entraîne, c'est un projet qui réveille les peurs occidentales (voir mon article du 21 janvier 2017).
J'étais là lors des premiers débats en 2014, à Dunhuang où j'ai appris à entendre les discours des experts, découvrir les voies ferrées, imaginer les voies maritimes. Les cartes défilaient, les agencements...

Certains experts en géopolitique diront que cette idée est, avant tout, une idée occidentale pour générer un gain de temps dans les échanges commerciaux, particulièrement depuis leurs usines de production en Chine.
Le projet OBOR est notamment constitué du tronçon d'autoroute de 213 kilomètres entre Kashgar et Erkeshtam (ce dernier est entré en service en septembre 2013). La partie chinoise de cette route sera constituée des passages par Lianyungang, dans la Province du Jiangsu, et Xi'an, dans la Province du Shaanxi, et par la région autonome ouïghour du Xinjiang.
Cette route rejoint l'Europe en passant par le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Iran et la Turquie. Côté chinois, on achève le Xinsilu, une quatre-voies de 5 000 km qui relie la mer Jaune aux monts Tian. Un axe qui a pour but de délester la route maritime, par laquelle transitent des millions de conteneurs par an.
Deux autres routes sont envisagées pour rejoindre l'Europe : une passant par le Kazakhstan et la Russie, et l'autre traversant le Kazakhstan via la mer Caspienne. Les travaux ne sont pas financés par l'Union européenne, qui n'apporte aucune aide logistique. Les bailleurs sont la Banque européenne de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque de développement islamique.
Cette route permet notamment de faciliter le commerce entre la Chine populaire et les pays d'Asie centrale, dont les échanges s'élevaient à 25,2 milliards de dollars américains en 2008. Une liaison ferroviaire allant de la région autonome ouïghoure à l'Iran et desservant le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Afghanistan est également envisagée.
La route du sud, via la Turquie et l'Iran, est pour l'instant délaissée en raison des sanctions de l'ONU imposées à l'Iran. Ce pays est par ailleurs en conflit avec ses voisins sur le partage des eaux de la mer Caspienne.
Évidemment, les routes maritimes vont relier le continent africain, puis l'Argentine, le Chili, etc. Le monde tourne ainsi dans une proximité plus grande.

La Route de la Soie un projet d'avant garde
Ee 2014, dans les colonnes de Chine-Info, j'écrivais un article sur la Route de la Soie. J'y indiquais "parler aujourd’hui de la « Route de la Soie » et se lancer dans sa construction moderne est un pari titanesque. Ce projet soulève tant de questions aussi bien techniques qu’environnementales, culturelles et sociales. En écoutant les différentes présentations, en prenant le temps de confronter ma vision de la « Route de la Soie » à celle proposée, je me suis aperçue que j’étais tournée vers le passé. Sans doute est-ce là un problème typiquement français. J’ai donc essayé de faire un schéma d’un côté la colonne contenant « ce que je sais de la route de la soie » et l’autre « le futur de la route de la soie ». La colonne de gauche était bien remplie. Elle comprend les histoires, les mythes, les biens échangés, les savoirs décortiqués, les attaques de brigands. Elle est peuplée de couleurs et de beaux paysages. De l’autre la colonne de droite demeure vide. Je m’aperçois que je ne m’étais jamais posée la question. Pourtant au fur et à mesure des débats, j’ai commencé à la dessiner. Elle est rapide, traverse des paysages somptueux peuplés d’histoires anciennes. Elle est écologique, les échanges se font sans problème aux frontières. Elle est un lien d’amitié entre les peuples. Cette route, cette ceinture, c’est l’avènement d’une nouvelle civilisation."

En 2015, à Ürümqi, après avoir découvert le Xinjiang pendant plus d'un mois. Après avoir arpenté la Route de la Soie du nord, du sud, avoir traversé le désert du Taklamakan, j'ai participé au forum "Building the Silk Road".

À nouveau, pour j'écris pour Chine-Info, un article qui sera suivi d'un petit livre de photographies (chez JFE). "Pour évoquer la Route de la Soie, il faudrait narrer les heures à imaginer sur une carte un impossible tracé. Et puis, il y eut l’audace de ma demande, celle de parcourir la zone qui se situe au Xinjiang, soit à peu près six mille kilomètres en passant par Ürümqi, Kuqa, Turpan, Kachgar, Hotan, Yengisar…
Au fil des kilomètres, des paysages renversants, des lumières aux mille couleurs, des défis technologiques, des paris écologiques, des histoires singulières. Ici plus qu’ailleurs, la Chine dessine son histoire, elle est composée de ses ethnies. Nous oublions souvent que la Chine compte plus de cinquante ethnies ! Les visages, les corps sont différents, les habitudes aussi, le temps prolonge l’espace autrement. Les lumières s’attardent sur les déserts devenus des roches, les longs couloirs de vent font vibrer les éoliennes en une chorégraphie majestueuse. Le ballet de scintillement des panneaux solaires nous fait entrer dans une autre dimension. le Xinjiang d’aujourd’hui écrit celui de demain. Le futur est une impression du présent. Le passé est là, les vestiges partout ornent la route et apportent une halte de l’histoire. Le passé a une place bien particulière dans le Xinjiang : au travers des musées, des vestiges, des traces de route, etc."
Un projet d'avant-garde ? Cela signifie, un projet qui porte en son coeur l'union des civilisations. La possibilité d'avancer ensemble, de révéler une fraternité entre les peuples, les civilisations. Je ne vais pas ici rappeler que, pour moi, la fin des lumières riment avec la fabuleuse leçon de géographie philosophique d'Emmanuel Kant. Pour réinventer les Lumières nous avons besoin de cette route. Elle est l'équilibre du monde. Mais pour que cet équilibre ait lieu, il va falloir que, de notre côté, nous dépassions nos barrières mentales. Et ceci n'est rendu possible que par la pédagogie.
La Route de la Soie a besoin de pédagogie
Ce matin Xi Jinping affirme "s'étendant sur des milliers de kilomètres et riche d'une histoire millénaire, l'ancienne Route de la soie incarne l'esprit de la paix et la coopération, l'ouverture et l'inclusivité, l'apprentissage mutuel et les bénéfices réciproques".
Dans ses mots, il y a la philosophie du "gagnant-gagnant". Tout à la fois philosophie et stratégie, cette expression est la grande angoisse occidentale.
C'est précisément cela qui m'intéresse, éviter que les habitudes culturelles de notre pensée enracinée fassent reculer ce projet collaboratif. Une des raisons qui m'ont fait choisir de rester à Paris ce week-end et d'enseigner la communication de crise, c'est pour montrer combien, il est facile de programmer un cerveau, en lui donnant à voir une seule partie de l'information. Alors, oui, en France nous avons, comme par hasard, Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin qui vont représenter les intérêts français, évoquer des stratégies commerciales... Et vous allez aussi entendre parler de la Route de la Soie de façon négative (voir comme "La Route de la Soie : Pékin déploie ses tentacules" dans Libération).
En 2014, déjà je notais que certes la Route de la Soie allait devoir inventer, générer une nouvelle vision de l'économie. Avec des notions de monnaies nécessaires, des indicateurs locaux de bien-être, mais aussi et surtout déployer une pédagogie immense. Eduquer, éduquer, éduquer pour éviter les freins d'une opinion publique noyée dans la désinformation, les fake news et dont l'ennemi principal n'est ni Daesh ni l'Arabie Saoudite, ou autre, mais bien la Chine. Le géant qui fait peur... Pourquoi en est-il ainsi ? Simplement parce que la pensée chinoise est une pensée du flux, du mouvement, elle est organique, mouvante, vivante... tandis que notre pensée occidentale est enracinée. Par le fait même de cet enracinement, elle est limitée, bloquée, coincée dans un choix perpétuel entre le "bien" et le "mal", entre "gagner" ou "perdre". Or la Route de la Soie est à l'inverse : humaine, faite d'échanges. Elle tisse les liens entre les individus, entre les savoirs.
En 2014, je concluais ainsi "De l’éducation à la politique, de la pensée à la réalisation, ce rêve chinois me porte. Cette route de la soie réveille le mythe de l’ailleurs, la volonté de se dépasser, de se transcender afin de bâtir ensemble quelque chose de meilleur, de nouveau. En revenant à Paris, je ne cesse d’y penser. Construire une société moderne, c’est lui donner la matière d’un rêve à bâtir, c’est rassembler les volontés, à ce moment là seulement l’harmonie peut naître. Comme un juste équilibre entre le corps et l’esprit, entre l’individu et le collectif."
Nous sommes en 2017, et j'essaye d'être fidèle à cette vision d'ouverture avec la mise en place d'une maison d'édition indépendante : La Route de la Soie - Éditions. Et évidemment, je continuerai à enseigner, à faire prendre conscience de nos enfermements culturels.
Evidemment, écrire, photographier, rencontrer, faire parler les cultures, les légendes, plusieurs ouvrages sont à venir en ce sens... et parce que je partage complètement cette idée émise, ce matin, par Xi Jinping : "L'esprit de la Route de la soie est devenu un grand héritage de la civilisation de l'humanité" je mettrai en oeuvre un projet qui me tient à coeur : un lieu d'éducation, d'apprentissage des civilisations.
Tout ne se fera pas en un jour, mais comme le dit Ella Maillart :
"l'impossible recule face à celui qui avance".
Voilà pourquoi j'ai choisi de venir vous enseigner hier. Une pierre de touche face à l'impossible. Et qui sait, demain, peut-être, aurais-je la chance de rencontrer Xi Jinping en direct. A mes étudiants, je dirai simplement ceci "La Route continue, les rêves aussi, ne lâchez rien, ne baissez jamais les bras, tout est possible"...