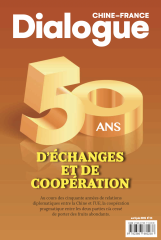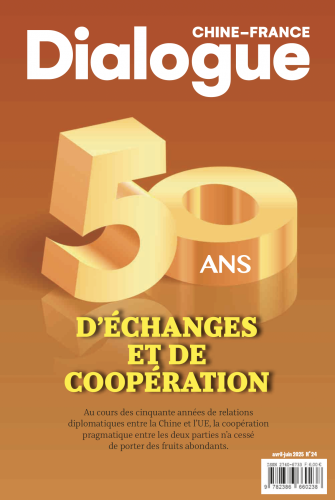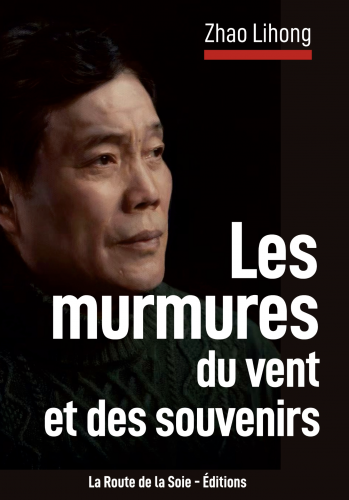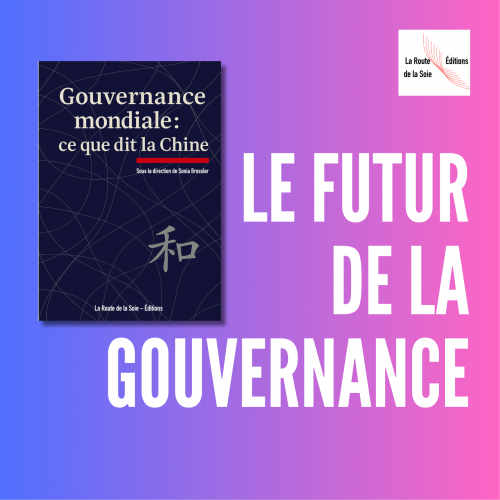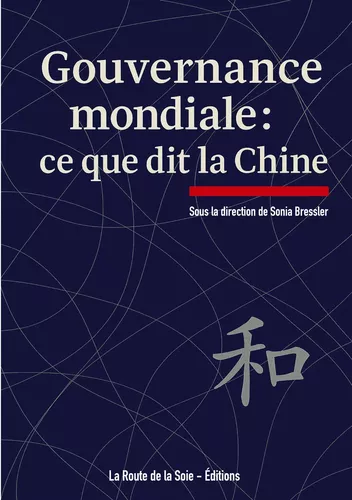Quand l’été devient surexposé – halte à la Main de Fer
Depuis le mois de juin, Perpignan vit dans une lumière qui ne connaît plus la nuance. Les murs s’écaillent de blanc, les feuillages passent du vert tendre au jaune sec, l’air vibre comme une toile tendue. Les ombres se rétractent, tout semble surexposé, comme un polaroid oublié au soleil. Et l’on se surprend à poser cette question simple : qu’est-ce que l’été, au juste ?
Pour les Anglo-Saxons, Summer est un mot incandescent, saturé de promesses : villas aux façades franches, piscines turquoises, barbecues dans la douceur du soir, corps allongés sur des transats impeccablement alignés. Pour d’autres, l’été est un temps où le monde ralentit, où les heures s’étirent jusqu’à se dissoudre dans la chaleur. Mais derrière l’éclat des couleurs, il y a aussi une part d’ombre : l’ennui, l’attente, l’isolement. Les couleurs vives peuvent être les rideaux tirés sur nos solitudes.

Dans la rue de la Révolution française, une porte entrouverte semble proposer un répit : c’est la Galerie de la Main de Fer. Du 13 juin au 16 août, l’exposition SUMMER invite à traverser ce seuil comme on plonge dans une eau fraîche après des heures de soleil. Là, cinq artistes réinventent la saison chaude, chacun à sa manière, entre figuration narrative et méditation visuelle.
Voyages immobiles – Yannick Fournié
Chez Yannick Fournié, l’été n’est pas fait de cartes postales bruyantes. Il est une architecture immobile, un face-à-face silencieux entre le construit et le vivant. Les formes sont réduites à l’essentiel, les couleurs tracent un équilibre presque mathématique. Au milieu, un personnage solitaire, témoin d’un monde figé. C’est un été où le temps a cessé de couler, où l’espace devient le reflet d’une intériorité apaisée – ou suspendue.
Balises d’humanité – Élia Pagliarino
Élia Pagliarino glisse dans ses céramiques des histoires venues de tous les horizons. Des Balises qui sont comme des bouteilles à la mer de l’humanité : elles portent en elles plus de 250 chroniques de vies réelles, venues du Japon, de l’Ouganda, de la Thaïlande ou de l’Angleterre. Ce sont des ventres d’argile, chargés de mémoire, qui racontent comment les êtres – humains ou animaux – se soignent mutuellement, s’accompagnent, se reconstruisent. Dans sa vision, l’été est un temps pour accueillir ces récits, pour écouter ce que nous n’avons pas le temps d’entendre dans le tumulte ordinaire.

Vacances désertées – Marie Vandooren
Avec Marie Vandooren, les espaces de loisirs se transforment en décors fantomatiques. Piscines abandonnées, terrains de sport sans joueurs, aires de jeux silencieuses. Ces lieux conçus pour le collectif deviennent les scènes d’un théâtre déserté. Les couleurs restent vives, presque criardes, mais elles semblent peindre l’absence plutôt que la fête. Ici, l’été n’est plus une promesse d’effervescence : il devient l’écho d’un monde qui s’éloigne.
Créatures et silences – Nathalie Charrié et Corinne Tichadou
Nathalie Charrié invente des formes hybrides, à la frontière de l’animal et du végétal. Sa céramique se marie au verre pour saisir l’illusion du mouvement, du souffle. Corinne Tichadou, quant à elle, offre une nature stylisée, verticale, dans des teintes de rose poudré et de bruns chauds. Palmiers et cactus y deviennent icônes du silence estival. La chaleur n’y est pas oppressante, elle est comme filtrée par un voile délicat.
Et toi, que cherches-tu dans l’été ?
Au fil des salles, on comprend que SUMMER n’est pas qu’une célébration de la belle saison : c’est une interrogation sur ce que nous y mettons. Le soleil peut tout autant révéler qu’il peut masquer. Les couleurs franches peuvent être un langage d’ouverture ou un écran lumineux derrière lequel on cache nos manques.
L’été, au fond, n’existe pas vraiment : il est un état d’esprit. Certains le vivent comme une conquête, d’autres comme une retraite. Il peut être une fête saturée ou un moment pour se retirer du monde. Dans la lumière crue de Perpignan, la galerie devient un lieu où l’on reprend possession de son regard.
Et c’est peut-être cela, la vraie fraîcheur dans l’été : retrouver le droit de voir autrement.
SUMMER – Galerie de la Main de Fer, Perpignan
Jusqu’au 16 août 2025